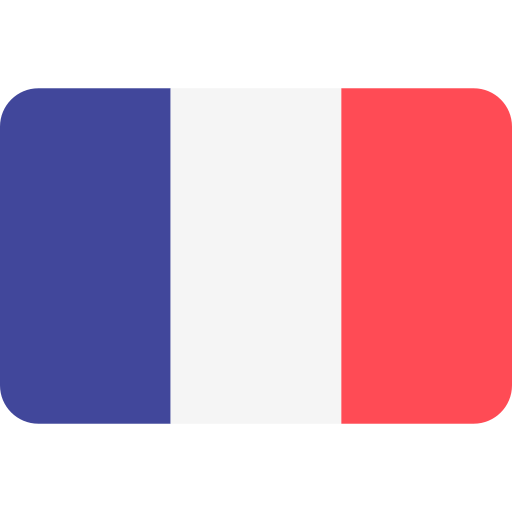Dette française, un risque de faillite ? Un déclin continu
Le 12 septembre, l’agence de notation Fitch a abaissé la note de la France de AA- à A+. C’est la première des trois agences principales à priver le pays de son « double A » et il est assez probable que Moody’s et S&P suivent la même voie dans les prochains mois.
En 2013, la France avait déjà perdu son « triple A », la meilleure note possible. Depuis le déclin a continué, porté par une dette publique qui ne cesse de s’alourdir , alimentée par un déficit public massif, l’un des plus élevés de l’Union européenne. En théorie, un déficit public de 3 % du PIB est considéré comme la limite à respecter pour stabiliser la dette. Or, la France en est loin : après 4,7 % en 2022, 5,4 % en 2023, le déficit a encore grimpé à 5,8 % en 2024. En 2000, la dette de la France représentait 60 % de la richesse nationale. Aujourd’hui, elle atteint 114 %.
Autrement dit, la situation ne s’est pas améliorée, bien au contraire : elle s’est dégradée ces dernières années. L’instabilité politique, illustrée par la succession rapide de premiers ministres, rend difficile la mise en place d’un plan crédible pour redresser les comptes publics. Dans ce contexte, la décision de Fitch n’a rien d’étonnant : elle souligne le déclin de la France et ses fragilités à la fois politiques et financières.
Comment les marchés réagissent-ils ?
À l’annonce de Fitch, les marchés financiers n’ont pas bronché : la dette française est restée au même niveau. Pour mesurer la perception des investisseurs, on compare généralement le rendement des obligations d’État françaises (les OAT) à celui de leurs équivalents allemands. Depuis la dissolution de juin 2024, l’écart a bondi de 0,30 %, pour atteindre 80 points de base. En réalité, cela fait déjà plusieurs mois que les investisseurs anticipaient le déclassement de la France dans le groupe des pays notés « A ». Résultat : les taux d’intérêt de la dette française sont désormais équivalents à ceux de l’Italie, et supérieurs à ceux de l’Espagne, du Portugal… et même de la Grèce.
Un scénario « à la grec » pour la France ?
La crise de la dette grecque avait éclaté en 2008 et conduit, dès 2010, à une mise sous tutelle du pays par l’Union européenne et le FMI, ainsi qu’à une restructuration de sa dette.
Peut-on imaginer un tel scénario pour la France ? La dette publique française a en effet fortement augmenté ces dernières années, au point que certains responsables politiques ont évoqué la possibilité d’une « faillite » de l’État. Mais si la comparaison avec la Grèce inquiète, plusieurs différences majeures permettent de nuancer le propos.
Aujourd’hui, la dette française atteint 114 % du PIB, soit le niveau de la Grèce en 2008. Mais la comparaison s’arrête là : l’ensemble de la zone euro est plus endetté qu’à l’époque (88 % contre 65 % en 2008). La crise du Covid a joué un rôle majeur dans cette hausse, avec +15 points pour la France. À titre de comparaison, les États-Unis sont aujourd’hui à 120 %, le Royaume-Uni à 100 %, et le Japon culmine à 237 %. La France n’est donc pas une exception.
Des comptes plus solides que ceux de la Grèce
En 2008, la Grèce avait dissimulé une partie de sa dette grâce à des montages financiers, ce qui avait aggravé la crise de confiance. Rien de tel pour la France, dont les compte publics sont considérés comme fiables.
Autres différences : la collecte des impôts, problématique en Grèce à l’époque, fonctionne bien en France. Enfin, l’État français détient d’importantes participations dans des entreprises, (environ 715 milliards d’euros). Si tout n’est pas immédiatement « vendable », une partie de ces actifs (environ 180 milliards) pourrait être mobilisée en cas d’urgence, soit l’équivalent de 5 % de la dette publique.
Autre élément d’importance, c’est le patrimoine des particuliers. Le patrimoine net moyen des français est estimé à 242 000 €, au-dessus de la moyenne européenne (225 000€). L’essentiel est constitué d’immobilier mais on estime à plus de 6 350 milliards d’euros la somme totale du patrimoine financier des français, soit presque le double de la dette de l’Etat (3 345 milliards d’euros). Une partie de cette épargne pourrait être sollicitée en cas de crise (ce qui doit d’ailleurs nous inciter à la prudence sur les supports d’investissement français, notamment les contrats d’assurance-vie). En 2025, le taux d’épargne des français est estimé à 19 % du revenu disponible brut. C’est le niveau le plus élevé en Europe. Face à un Etat dispendieux, les ménages font des économies.
Le psychodrame de la crise de la dette en zone euro a commencé avec la Grèce en 2010 et s’est poursuivi avec des tensions majeures sur l’Espagne, le Portugal, l’Irlande et l’Italie, ce qui a fait vaciller la monnaie unique. La BCE a alors abandonné son orthodoxie monétaire en créant des mécanismes de soutien inédit. Ces mécanismes existent toujours et pourraient être utilisés en cas de crise majeure sur la dette française. Ajoutons comme autre élément rassurant le poids de la France dans la zone euro : 18% du total , contre moins de 2 % pour la Grèce. Un défaut français provoquerait un séisme financier en Europe, ce qui rend ce scénario très improbable.
La situation actuelle
La situation budgétaire et politique pèse clairement sur les taux obligataires français. Aujourd’hui les échéances à 10 ans des OATs sont à 3.50%, un niveau parmi les plus hauts de la zone euro mais finalement assez proches de la moyenne (3.30%). Il convient aussi de noter que la maturité moyenne de la dette française est supérieure à 9 ans avec un taux moyen de 1.86% grâce aux années de taux quasi-nuls (2017-2021). Il y a une très grande inertie sur l’évolution de ce taux moyen et il faudrait un temps long pour qu’il remonte de façon significative.
Conclusion
La France fait face à une situation budgétaire et politique inquiétante mais qui n’est pas unique. Sans nier ces difficultés et ces défis, il existe des éléments qui permettent de penser que la France peut éviter aujourd’hui un scénario « à la grec ». Néanmoins, le temps presse.
Durant la crise de la zone euro, la France a été épargnée. Les pays qui ne l’ont pas été, ont pris des mesures correctives qui aujourd’hui portent leurs fruits. Faudra-t-il attendre un choc majeur des marchés pour agir, ou verra-t-on émerger des réformes courageuses pour rétablir les finances publiques ? Plus largement, la France est confrontée à des défis communs à toutes les démocraties occidentales. On parle du déclin continu de l’Europe face à l’Asie, du vieillissement de la population, des chocs technologiques et d’une réorganisation géopolitique au niveau mondial.